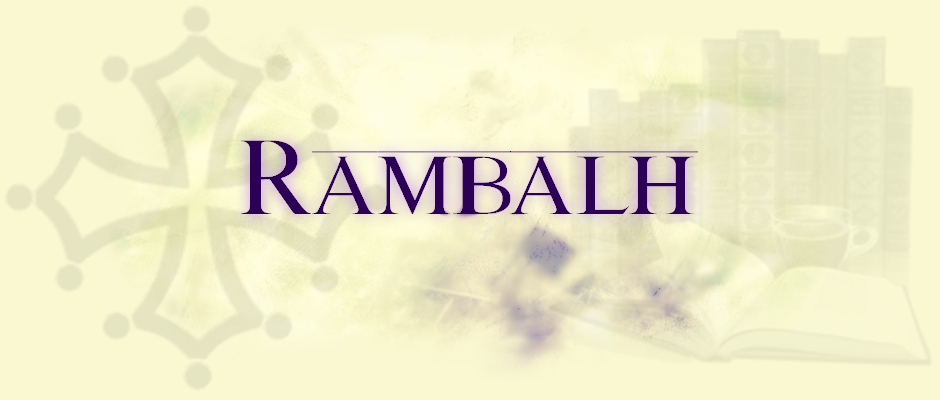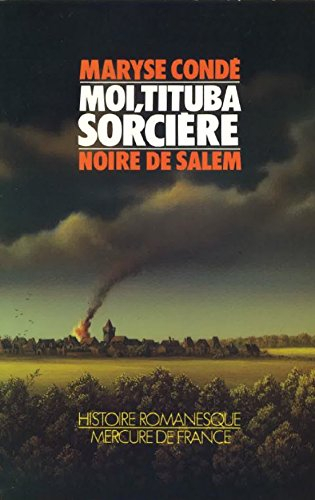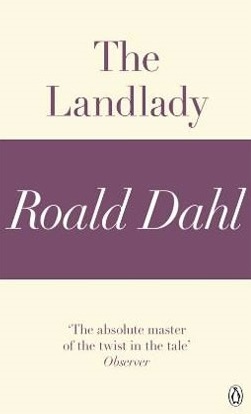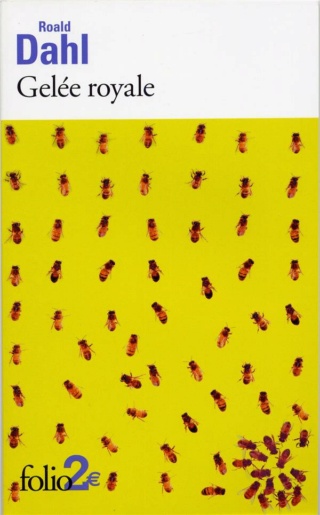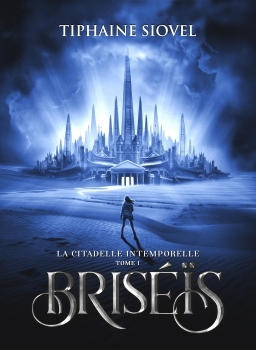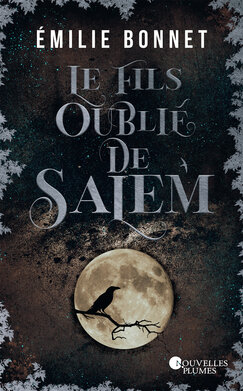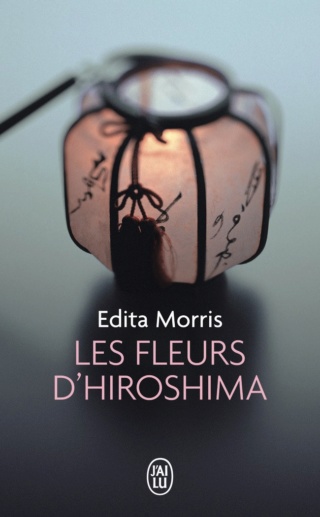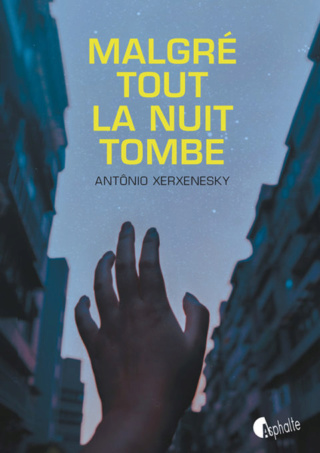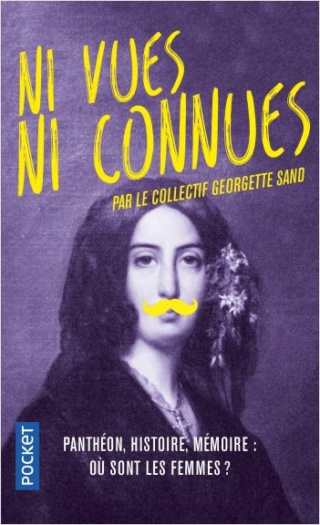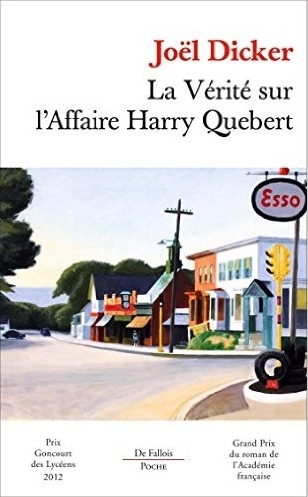Mes copains du forum
Accros & Mordus de Lecture m’ont offert pour mon anniversaire ce livre avec lequel je les avais peut-être un peu trop tannés ces dernières semaines. Et je l’ai évidemment dévoré immédiatement, attirée par cette promesse de réflexion féministe sur la condition humaine. Petit bonus : il fait partie de la liste des livres lus dans le cadre du club de lecture féministe
Our Shared Shelf fondé par Emma Watson.
 Quatrième de Couverture
Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ?
Quatrième de Couverture
Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ?
Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent « le pouvoir ».
Du bout des doigts, elles peuvent soudain infliger une douleur fulgurante - et même la mort.
Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le « sexe faible ».
Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre ?
Mon avis
Neil écrit à Naomi pour lui confier son manuscrit, une sorte d’hybride entre le traité d’histoire et le roman, une façon de conter les bases de la société dans laquelle il vit en romançant les zones d’ombre. Peu à peu, nous découvrons que la société dans laquelle il vit est un monde où les femmes dominent les hommes, où elles dirigent le monde et où elles imposent la moindre de leurs volontés. Neil raconte comment tout a commencé d’après ses recherches, comment selon sa théorie, le monde a basculé soudainement lorsque les femmes ont découvert qu’elles possédaient un pouvoir puissant et surtout capable de leur faire gagner l’épreuve de force.
Tout le roman s’articule autour de l’inversion du pouvoir à travers l’inversion du rapport de force. Naomi Alderman tisse tout au long de l’histoire les barreaux de la cage invisible dans laquelle l’humanité est enfermée depuis la nuit des temps : la prison du
pouvoir. Et c’est là le message important du roman.
Cette notion du pouvoir est essentielle pour comprendre le roman, elle permet d’appréhender le féminisme universel qui s’en dégage sans tomber dans la facilité de croire que ce livre décrit la misandrie.
Le Pouvoir décrit un monde où les femmes, désormais plus fortes que les hommes, renversent la société patriarcale en seulement dix ans mais, surtout, instaure une société tout autant oppressante. C’est là que citer Montesquieu est nécessaire pour saisir une partie du roman :
«
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » De l’esprit des lois (1748).
Et c’est ce que le lecteur aimerait voir, pour lire un roman féministe au premier degré : voir les femmes instaurer un monde où la séparation des pouvoirs retrouve son sens, où les qualités protectrices soi-disant naturelles des femmes s’imposent pour un monde meilleur. Évidemment, ce n’est pas le cas, et ce serait fichtrement simpliste et ennuyeux que ce le soit.
Lorsque les jeunes filles de quinze ans découvrent qu’elles sont capables de générer et d’envoyer des décharges électriques, soudainement, le monde s’enflamme. Les filles « deviennent » dangereuses, une façon pour Naomi Alderman de faire un clin d’œil à cette croyance selon laquelle les adolescentes sont les viles tentatrices qui, dès la puberté, détournent les gentils garçons du droit chemin. Incarné par ce pouvoir physique, la décharge électrique est lancée par la jeune fille là où dans notre réalité, c’est le charme vipérien de la femme qui fait vriller les connexions électriques entre les neurones des pauvres garçons. Mais rien n’est perdu, les gouvernements se préparent à enfermer les filles dans des centres spécialisés pour les « aider » à maîtriser leur pouvoir, pour les mâter, surtout.
Lorsque ces jeunes filles apprennent à réveiller le don chez leurs aînées, le monde bascule. 2duquer des jeunes filles qui sont malléables est une chose, se confronter aux femmes d’expérience en est une autre, ces femmes qui subissent l’oppression depuis bien plus longtemps que leurs filles. Et, automatiquement, ce monde patriarcal se met en alerte, non pas parce que sa santé physique est menacée mais bien parce que c’est son privilège qui l’est. Et on touche du doigt la critique des courants anti-féministes, ou encore le « masculinisme » qui n’existent que par opposition au féminisme : c’est en refusant encore une fois aux femmes la marche de l’égalité que ces hommes sont poussés d ans l’escalier violemment et se retrouvent à dégringoler les marches du pouvoir à une vitesse fulgurante.
Naomi Alderman nous transporte dans cette révolution aux quatre coins de la planète grâce à ses personnages. Elle nous offre aussi un effet miroir précis dans son inversion des codes. C’est d’ailleurs une partie assez simpliste de son roman, peut-être le point négatif de son histoire même si on en comprend le but. C’est d’abord au sein des sociétés où les femmes sont le plus oppressées que les choses vrillent : en Arabie Saoudite où les femmes se lancent dans une course à la terreur, mais aussi en Inde, dans les pays de l’Est de l’Europe où l’esclavage sexuel fait rage.
«
Maintenant, ils vont comprendre que ce sont eux qui devraient éviter de sortir de chez eux seuls la nuit, exulte une manifestante devant l’objectif de Tunde. Ce sont eux qui devraient avoir peur. »
Ce besoin de vengeance plus que de revanche fait rage chez celles qui ont été écrasées toute leur vie. Et cela inspire les femmes du monde entier qui s’élèvent chacune à leur façon : via de nouveaux courants religieux, l’art de la guerre, de la politique ou encore du truandage. Créer un réseau, jouer des coudes habilement pour influencer le maximum de personnes, tracer son chemin sur l’autoroute du pouvoir.
Ce pouvoir, encore et toujours, celui qui guide l’être humain. L’autrice distille parfaitement ce poison qui s’insinue dans l’ensemble de la société, changeant de camp avec le nouveau rapport de force.
«
Elle sait qu’elle ne doit pas le faire, qu’elle ne le fera jamais, mais là encore, peu importe. Tout ce qui compte, c’est qu’elle le pourrait si elle le voulait. Le pouvoir de nuire, de faire mal, est une forme de richesse. »
Les femmes, dans ce roman, ont pris le pouvoir parce qu’elles
le pouvaient. Elles s’en sont emparé dès qu’elles ont compris qu’elles étaient physiquement supérieures aux hommes et elles les ont écrasés progressivement, leur faisant oublier ce monde patriarcal qui n’est pas plus naturel que celui qu’elles imposent.
Dans sa société miroir, Naomi Alderman nous montre que les femmes en arrivent au même point que les hommes dans notre monde patriarcal : les hommes sont qualifiés d’émotifs, ils sont si faibles physiquement que les violer pour les briser est un jeu d’enfant, lorsqu’ils tentent de s’insurger les femmes se rient d’eux avec condescendance… Des dizaines de passages montrent à quel point il est facile de renverser la vapeur, jusqu’à la toute fin du livre et la conclusion de l’échange entre Neil et son amie. Si j’ai trouvé cet effet miroir trop simpliste, je dois reconnaître son utilité : il montre à quel point on ne domine pas l’autre par volonté immuable de la nature mais bien parce qu’on le peut.
«
Ce monde a toujours appartenu aux mâles : aucune des raisons qu'on a proposées ne nous a paru suffisante. C'est en reprenant à la lumière de la philosophie existentielle les données de la préhistoire et de l'ethnographie que nous pourrons comprendre comment la hiérarchie des sexes s'est établie. Nous avons posé déjà que lorsque deux catégories humaines se trouvent en présence, chaque catégorie veut imposer à l'autre sa souveraineté ; si toutes deux sont à même de soutenir cette revendication, il se crée entre elles, soit dans l'hostilité, soit dans l'amitié, toujours dans la tension, une relation de réciprocité : si une des deux est privilégiée, elle l'emporte sur l'autre et s'emploie à la maintenir dans l'oppression. On comprend donc que l'homme ait eu la volonté de dominer la femme : mais quel privilège lui a permis d'accomplir cette volonté ? » Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Tome I (1968).
Naomi Alderman dénonce donc ce problème du pouvoir qu’elle tisse tout au long de son roman, ce pouvoir qui empêche les êtres humains de vivre ensemble et qui pousse le groupe d’individus les plus forts à écraser les autres. Elle nous offre un pan de réflexion autour de notre société et des différentes luttes qu’elle connaît en nous expliquant en presque quatre cents pages que l’égalité ne s’obtient pas en changeant le pouvoir de mains.
Quiconque a le pouvoir finit par en abuser parce qu’il le peut.
«
Les puissants, qu'ils soient prêtres, chefs militaires, rois ou capitalistes, croient toujours commander en vertu d'un droit divin ; et ceux qui leur sont soumis se sentent écrasés par une puissance qui leur parait divine ou diabolique, mais de toute manière surnaturelles. Toute société oppressive est cimentée par cette religion du pouvoir, qui fausse tous les rapports sociaux en permettant aux puissants d'ordonner au-delà de ce qu'ils peuvent imposer ; il n'en est autrement que dans les moments d'effervescence populaire, moments où au contraire tous, esclaves révoltés et maîtres menacés, oublient combien les chaînes de l'oppression sont lourdes. » Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale (1934).
Et c’est à travers cette critique du pouvoir que ce livre est, dans son ensemble, féministe. Naomi Alderman montre que le féminisme misandre n’est pas la solution, que changer le pouvoir de mains ne réglera pas le problème de l’oppression. Le
totalitarisme reste un pouvoir à combattre et c’est par une vraie définition égalitaire que la société pourra évoluer. Finalement, en caricaturant un peu les dérives de l’oppression et du renversement du pouvoir, Naomi Alderman nous pousse discrètement à nous questionner sur l’essence du pouvoir et ses dérives. Plusieurs courants féministes sont d’ailleurs engagés dans la déconstruction du pouvoir au profit de tous : le féminisme n’est pas un moyen de piquer les parts de gâteaux aux hommes privilégiés mais plutôt de donner la possibilité à tous les êtres humains d’obtenir directement leurs propres gâteaux.
Il y a encore énormément de choses à dire sur ce livre, mon exemplaire est truffé d’annotations et de post-it mais, en même temps, on peut tout aussi bien se contenter de résumer l’impact de l’ouvrage à la
nécessité de questionner le pouvoir et son abus.
À tous les lecteurs déçus parce qu’ils pensaient que le féminisme serait premier degré, je ne peux que rappeler que le but d’un roman d’anticipation n’est pas de toucher du doigt un monde parfait, puisque chaque utopie a dans tous les cas ses dérives. Si
Le Pouvoir est un roman assez facile et caricatural par moment, il a le mérite de faire réfléchir et de pousser à faire quelques recherches sur les notions de pouvoir et d’oppression. Et il me donne envie de lire les essais de Simone Weil même si la complexité de la philosophie m’a toujours effrayée.
Les avis des Accros & Mordus de Lecture