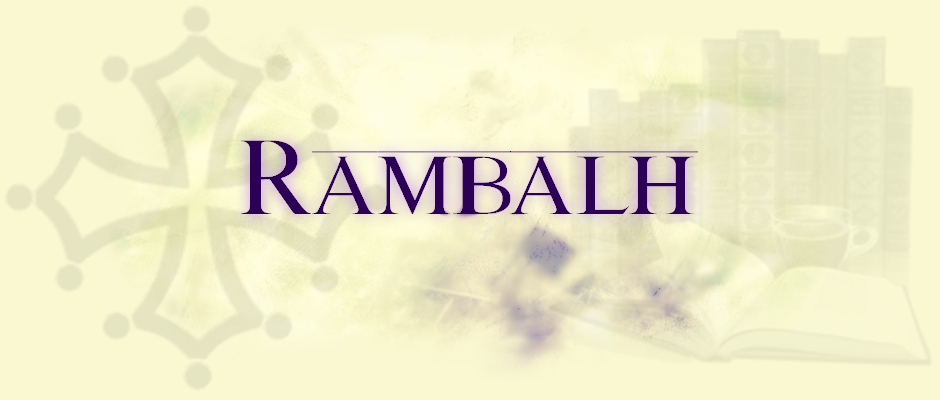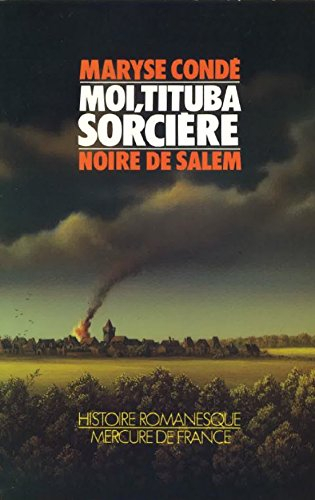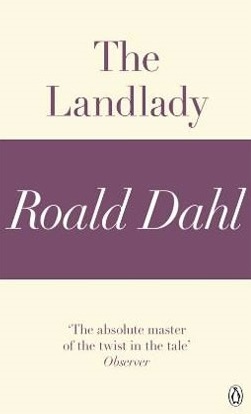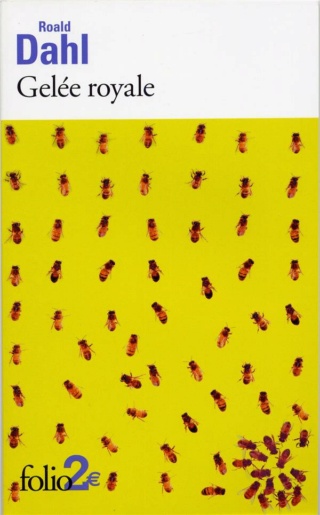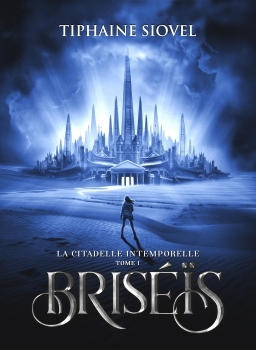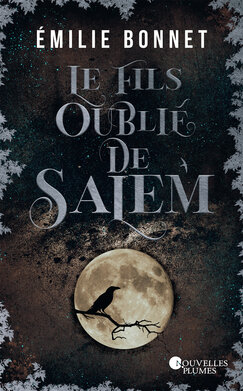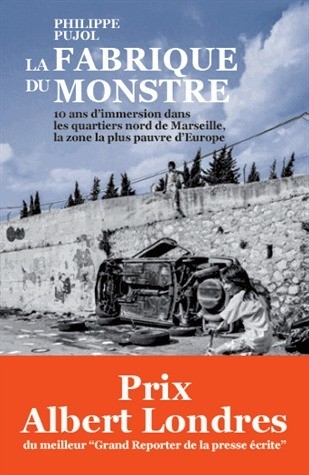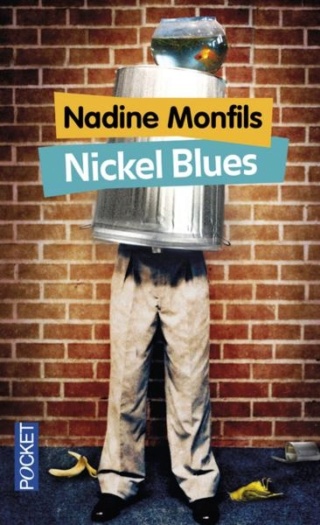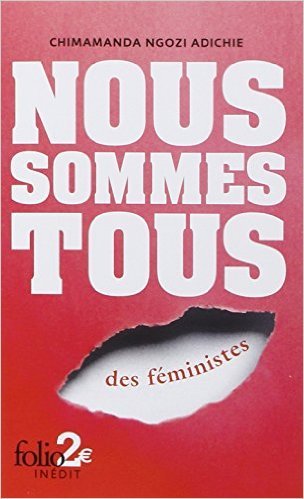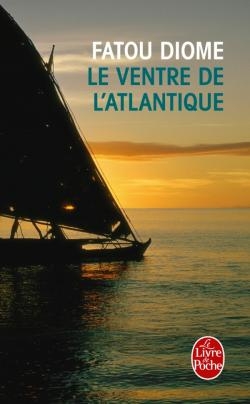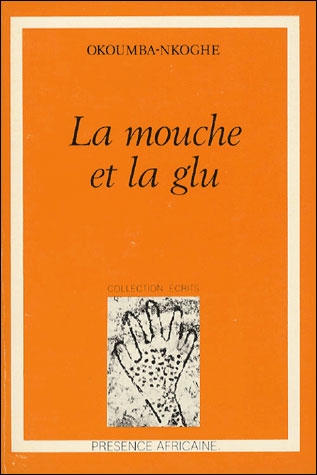Quatrième de Couverture
« Quand tu prononces un mot comme celui-ci, tu ne peux plus faire marche arrière. Fais comme s’il ne s’était rien passé. C’est plus simple comme ça. Plus simple pour toi. »
Emma a dix-huit ans, c’est la plus jolie fille du lycée. En plus d’être belle, elle est pleine d’espoir en l’avenir. Cette nuit-là, il y a une fête, et tous les regards sont braqués sur elle.
Le lendemain matin, ses parents la retrouvent inanimée devant la maison. Elle ne se souvient de rien. Tous les autres sont au courant. Les photographies prises au cours de la soirée circulent sur les réseaux sociaux, dévoilant en détail ce qu’Emma a subi. Les réactions haineuses ne se font pas attendre ; les gens refusent parfois de voir ce qu’ils ont sous les yeux. La vie d'Emma est brisée ? Certains diront qu'elle l'a bien cherché.
Mon avis
Je ne vais pas résumer le synopsis de ce bouquin mais me contenter d’abord les points importants à mes yeux. Une fille facile traite du viol du point de vue de la victime mais, ici, la victime culpabilise. La victime se place comme responsable de son viol, et le voit comme sa propre erreur de parcours. Emma encaisse, elle garde la tête haute, au début, persuadée que sa place dans la hiérarchie sociale de son lycée et même de sa ville suffira à faire oublier cet épisode. Elle s’excuse. Elle regrette d’avoir mis ses agresseurs dans cette situation.
Et tout au long du roman, son corps et son esprit divaguent. Elle ne se voit que comme les bouts de sa chair qui circulent en photo sur les réseaux sociaux. Elle perd peu à peu son humanité dans ses propres yeux. Elle, la victime, se retrouve à s’effacer, à effacer sa place en tant qu’être humain. Elle se coupe des autres, du monde, de sa personnalité, de ce qu’elle est. Elle regrette. Elle voudrait tout effacer. Ce n’est même pas le viol en lui-même, son agression, qu’elle souhaite effacer, mais toutes les conséquences qui en découlent.
Et c’est là le cœur du roman. Nous vivons dans une société où l’on apprend aux femmes à se protéger des violeurs plutôt que d’apprendre aux hommes qu’il ne faut pas violer. On doit être constamment sur nos gardes parce que la société est incapable d’expliquer aux êtres humains que le corps des femmes n’est pas un objet public dont on peut user et disposer à l’envie. Emma ne se considère plus que comme un bout de viande. Quand elle se regarde dans le miroir, tout ce qu’elle voit, c’est les photos en gros plan de son corps, ces parties dissociées. Elle ne se sent plus entière, elle n’est que des morceaux assemblés qui lui ont été pris par ces hommes, ces garçons qu’elle connait bien, en qui elle avait confiance.
Emma est la méchante de cette histoire dans le regard des autres, elle est celle qui fait naître le scandale, celle qui a trop bu, celle qui allume, celle qui mérite ce qui lui arrive. Et c’est révoltant. C’est révoltant parce que, sous couvert de fiction, c’est ce qui arrive tous les jours, c’est ce qu’on dit aux femmes. Même sous la compassion il y a ces mots, ces phrases « Mais tu devais bien te douter qu’il y avait un problème » « Tu n’aurais pas dû t’habiller comme ça » « Tu vois, à force de te frotter à des inconnus… »
Une fille facile dénonce tout ce qui fout la gerbe dans notre société soi-disant évoluée. Une fille facile nous rappelle encore que la victime est bien plus jugée que le ou les agresseurs. Parce que porter plainte, subir les interrogatoires, le procès, l’exposition de sa vie privée, de son intimité… C’est autant d’obstacles à la dénonciation que de conséquences d’une agression sur une personne. Parce qu’elle a été violée Emma devra justifier toute sa vie chacun de ses actes avant et pendant cette soirée, même après. Alors que ce sont les agresseurs les bourreaux, les coupables. Être une victime c’est voir sa parole remise en cause, c’est revivre sans cesse la scène à mesure qu’on doit la raconter, c’est devoir affronter encore et encore un souvenir déchirant, c’est devoir rappeler inlassablement que c’est l’agresseur le coupable, celui qui a agi sans consentement.
La fin de ce roman est un coup dans le cœur mais elle est criante de réalité : en Irlande, les agresseurs s’en sortent souvent. Rappelez-vous le procès récent où un violeur a été acquitté parce que sa victime portait un string ? Et il n’y a pas qu’en Irlande que cela arrive. Pourquoi ? Parce qu’on élève filles et garçons en leur faisant croire que le viol c’est l’inconnu bizarre qui va t’entraîner dans sa cave. On tait le fait que, dans la majorité des cas, le viol est commis par quelqu’un qu’on connait, dans une situation où il n’y pas toujours de violence, avec cette foutue zone grise qui est encore un moyen de dire « oui mais peut-être que ». Une fille facile est une grosse claque qui rappelle que le monde dans lequel on vit ne tourne pas rond, que le corps des femmes reste un appel au sexe quelle que soit notre tenue et que, quoi qu’il arrive, on est toujours un peu coupable de ce qui nous arrive dans les yeux des autres. Une fille facile me pousse à toujours plus parler de féminisme, à rappeler aux gens, hommes comme femmes, que le consentement c’est pas compliqué, que tant que des romans comme celui-là reflèterait encore la réalité il faudra se battre.
Une fille facile est un roman fort parce que tout est fait pour que l’héroïne agace au début, pour que le lecteur en vienne à se dire à un moment « mais qu’elle est conne » dans le but de lui rappeler que personne ne mérite ça. Personne. Pas même les gens qui nous irritent, pas même ceux que nous n’aimons pas. Personne ne mérite de subir une agression, d’être maltraité, d’être réduit à un simple corps sans âme. Personne ne mérite d’être une victime que l’on place ensuite sur l’échafaud pour l’ériger en coupable.
Une fille facile est à mettre entre toutes les mains des personnes qui pensent encore qu’on se fait violer uniquement parce qu’on l’a bien cherché. C’est un roman à lire pour comprendre à quel point réduire une personne à l’état d’objet lui fait oublier qu’elle est un être humain avant. C’est un roman à lire pour ne pas oublier que le chemin à parcourir est encore long.
Et je vous laisse trois citations montrant l'essentiel (même si il y a encore des tas de passages significatifs à relever) :
« Les jupes au ras des fesses , les hauts échancrés jusqu'au nombril, et elles boivent toutes trop et trébuchent dans les rues, elles poussent au crime, et quand ce qui doit arriver arrive, elles se plaignent et se mettent à pleurnicher. Comme disait votre autre intervenant, à quoi d'autre peuvent- elles s'attendre ? »
« C’est dommage qu’Emma ait eu plus de dix-huit ans à l’époque sinon, il auraient pu être poursuivis pour possession et diffusion d’images pédophiles. Tellement plus simple à prouver que le problème du consentement. »
« On téléphone pour dire que je l'ai bien mérité. On dit que je l'ai bien cherche. Dans un premier temps, ca m'a fait mal d'entendre ce qu'on disait de moi. J'ai beaucoup pleuré au début. Je ne devrais probablement pas écouter. Mais personne ne me racontera rien. J'ai l'impression en permanence de finir un puzzle avec quelques pièces manquantes. »